Il y a trois ans, le 24 février 2022, l’Europe assistait au retour du tragique à ses portes avec l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie, ce qui brisait des années de stabilité et de paix sur le continent. Peu de monde prévoyait la survie de l’Ukraine, alors que Kiev devait tomber en quelques jours. Devant l’arrivée imminente de l’armée russe, on s’attendait au départ de Volodymyr Zelensky. Pourtant, ce dernier d’incarner la résistance héroïque de son pays en voulant rester coûte que coûte. Il déclarera « Je veux des munitions, pas une voiture. »
Alors que ce conflit devait être éclair, ce conflit d’usure entre dans la quatrième année et il est marquée par une brutalité rare. Il a fait des centaines de milliers de morts et de blessés, sans qu’il ne soit possible de quantifier précisément cela. À cela il faut ajouter les millions de déplacés ukrainiens à travers l’Europe, ce qui manquera durablement le Vieux Continent. Pendant ce temps, la Russie, malgré les sanctions économiques et les pertes militaires massives, continue d’avancer, village par village, avec une stratégie froide et implacable.
Mais derrière les statistiques et les combats, cette guerre dépasse le simple affrontement entre deux nations. Elle questionne l’ordre mondial, secoue les alliances historiques et redéfinit les priorités stratégiques des grandes puissances. L’Union européenne tente de devenir un acteur clé, mais ses divisions internes et ses dépendance, énergétique ou militaire, compliquent sa posture. Aux États-Unis, le soutien indéfectible de l’administration Biden à l’Ukraine est désormais confronté à des débats de plus en plus vifs, renforcés par l’élection de Donald Trump, qui promet une rupture dans la politique américaine et une paix rapide.
Sur le terrain, la guerre est un bras de fer quotidien. Des batailles longues et dramatiques – comme celles de Marioupol ou Bakhmout ont marqué les esprits par leur violence, mais les avancées, des deux belligérants, restent limitées. En 2024, la Russie a semblé reprendre l’initiative, tandis que l’Ukraine, malgré l’aide militaire massive de l’Occident, lutte pour maintenir ses lignes de défense. L’arrivée des F-16 ou des missiles ATACMS a redonné de l’espoir à Kiev, mais ces armes arrivent peut-être trop tard pour inverser durablement le cours de la guerre, avec le retour de Donald Trump qui inaugure une solution pacifique pour résoudre le conflit.
Cette guerre longue, pose de nombreuses questions cruciales : comment l’Ukraine peut-elle encore tenir face à l’usure et à la lassitude des soutiens occidentaux ? Jusqu’où la Russie est-elle prête à aller pour réaliser ses ambitions ? Et, surtout, quels scénarios se dessinent pour l’avenir, à l’heure où des négociations de paix entre la Russie et les États-Unis, autrefois impensables, les deux grands ennemis historiques, commencent à se matérialiser et déboucher sur le début d’un accord ?
Les enjeux restent plus élevés que jamais. Cette guerre n’est pas seulement celle de l’Ukraine. Elle incarne une lutte plus large entre deux visions du monde : celle des principes et celle de la force brute. Il ne faut pas s’en tenir uniquement aux faits : il faut chercher à comprendre, à poser les bonnes questions et à offrir des perspectives. Car comprendre ce conflit, c’est se préparer à ce qui vient ensuite – pour l’Ukraine, pour l’Europe et pour l’équilibre du monde.
Trois ans après le début de la guerre en Ukraine, ce conflit est un des événements géopolitiques les plus marquants des années récentes, puisqu’il risque de bouleverser l’ordre mondial tel que l’on connait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chaque offensive, chaque décision diplomatique redessine les lignes de force internationales et met en lumière les limites de notre système global. C’est une guerre qui dépasse les questions de territoire ou de pouvoir : elle est devenue un affrontement sur les principes mêmes de souveraineté, de justice et de liberté avec en point d’orgue, une remise en cause de l’ordre établi par les Occidentaux.
La fin des affrontements, probable en 2025, sera grandement facilitée par le retour de Donald Trump et elle nourrit autant d’espoir que d’incertitudes. Il est difficile d’imaginer une issue qui respecte l’intégrité de l’Ukraine tout en évitant un affrontement encore plus global à l’avenir. Les enjeux ne se limitent pas aux frontières de Kiev ou de l’avenir du Donbass : ils touchent aux fondations mêmes de l’ordre international, à la capacité des nations à défendre leurs valeurs face à l’agression et surtout à la capacité des Européens à maintenir la paix sur leur continent.
L’Ukraine est à bout de souffle, épuisée par une guerre de position où l’élan du début a laissé place à une résistance acharnée mais incertaine. De plus elle reste très dépendante de l’aide américaine, ce qui fait craindre une issue amère si les discussions s’éternisent. De l’autre côté, la Russie avance, toujours au prix de sacrifices humains colossaux, fidèle à une logique de guerre d’usure qui lui a déjà permis de grignoter des territoires clés. L’hiver, avec ses défis logistiques et humains, n’a été qu’un nouvel épisode de cette guerre sans fin et a confirmé la domination russe.
Face à cela, la communauté internationale a une responsabilité historique. Continuer à soutenir l’Ukraine, oui, mais aussi savoir tracer les contours d’une paix qui ne soit ni un abandon, ni une capitulation. Car au-delà de l’Ukraine, c’est la crédibilité du Occidentaux et la sécurité de l’Europe qui sont en jeu. À ce titre, l’Europe est comme spectatrice de sa propre histoire, incapable de jouer un rôle stratégique déterminant. Pourtant elle sera impliquée dans la sécurisation post-conflit, ce qui implique le nécessité de se saisir de l’opportunité et de s’imposer aux yeux du monde. Plus que sa sécurité, c’est son avenir comme puissance géopolitique qui est en jeu ici.
Pourtant, l’Histoire a prouvé que les moments de crise sont aussi des opportunités pour bâtir un avenir différent. Mais cela exige une détermination sans faille, des choix courageux, et surtout une vision claire. L’Ukraine ne peut porter ce fardeau seule et l’Europe se doit d’être au rendez-vous de l’histoire. Si le monde souhaite un futur où les principes l’emportent sur la force brute, il est temps d’agir, et vite.
Par Pierre Clairé, Directeur Adjoint des études du Millénaire.
William Thay, Président du Millénaire.
Crédit photo : Donald Trump avec Vladimir Poutine via Flickr sous licence du domaine public
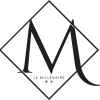

Add a Comment