L’envoi de deux sous-marins nucléaires par les États-Unis montre que l’administration Trump ne tente plus d’amadouer Poutine mais adopte un rapport de force avec la Russie. Le président américain a ainsi changé son fusil d’épaule en lançant un ultimatum au président de la Fédération de Russie, lui donnant jusqu’au 8 aout pour mettre fin à la guerre et, in fine, pour parvenir à un accord de paix avec les Ukrainiens. Pour autant, Donald Trump a-t-il vraiment la capacité d’obtenir une paix en Ukraine ou ces menaces se limitent-elles à des coups de communication sans fondement ?
Trump change de stratégie avec toujours le même objectif de paix en tête
Vladimir Poutine traîne dans les négociations depuis le retour de Trump à la Maison Blanche en janvier dernier. Cette situation irrite le président américain, car il veut en finir avec un dossier devenu encombrant. On se souvient tous du slogan martelé lors de sa campagne présidentielle selon lequel il allait mettre un terme à la guerre en moins de 24 h. Force est de constater que, 6 mois plus tard, et à part des échanges de prisonniers entre les deux camps, aucune avancée concrète vers un processus de paix n’a été réalisée. Les Russes continuent de gagner du terrain lentement mais surement et les Ukrainiens de se défendre tant bien que mal. Ce véritable statu quo dans les négociations vient entacher le bilan et la crédibilité de la présidence de Trump, censée incarner le retour d’une Amérique forte sur la scène internationale.
Face à cette impasse et fidèle à son art du deal, Trump durcit sa communication pour espérer faire bouger Poutine. La stratégie est bien rodée : menacer Poutine avec un ultimatum pour espérer le faire revenir à la table des négociations. De plus, l’envoi de sous-marins nucléaires vise à donner du corps à cet ultimatum. Pour Trump, tout l’enjeu est de ne pas perdre la face, parce que sa crédibilité est en jeu après avoir promis une paix rapide en Ukraine. Seulement, il fait face à une difficulté car il n’a que peu de leviers pour imposer la paix. Il ne peut aider l’Ukraine à gagner la guerre sans une aide miliaire massive supplémentaire pour changer le cours du conflit. Car il n’existe pas de solution miracle : sans un appui avec des troupes américaines au sol engagées face aux Russes, Kiev n’a aucune chance. Alors, pour ne pas finir comme Joe Biden, à qui le retrait catastrophique d’Afghanistan colle à la peau, Trump doit arracher un accord de paix pour espérer sortir la tête haute.
Les leviers sur lesquelles s’appuyer pour forcer Moscou à négocier
Trump pourrait bien s’appuyer sur plusieurs stratégies pour mettre sa menace d’ultimatum à exécution puisqu’il dispose de leviers militaire et économique. Pour contraindre le président russe à la paix, il faut que le cout de poursuivre le conflit et ses objectifs de guerre en Ukraine soit plus important que ceux d’un cessez-le-feu.
Sur le levier militaire, Donald Trump a plusieurs atouts dans sa manche. Il peut continuer à alimenter les Ukrainiens par le renseignement militaire américain. Cela permet à Kiev de mieux anticiper les offensives russes sur le terrain. De plus, il peut renforcer la décision de la vente de matériel militaire américain aux alliés de l’Otan qui soutiennent ensuite l’Ukraine, en augmentant et en étendant les armes capables d’être fournies à l’armée ukrainienne. Un enregistrement avait fuité entre Zelensky et Trump où ce dernier demandait s’il était capable de frapper la Russie et Moscou.
Sur le levier économique, les États-Unis ont la capacité de mettre à mal l’économie russe, notamment en agissant contre le contournement des sanctions par la Russie afin de maintenir leur chaine d’approvisionnement. Ainsi, Donald Trump pourrait sanctionner les pays tiers qui isolerait Moscou de ses alliés. C’est par ailleurs une piste privilégiée à l’encontre de pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil qui achètent des hydrocarbures russes et contribuent ainsi indirectement au financement de l’offensive russe en Ukraine. Le sénateur républicain Lindsey Graham propose d’aller encore plus loin en préconisant des droits de douane de 500% aux pays achetant de l’énergie russe. De même, Trump pourrait agir sur le prix des hydrocarbures en abaissant le plafond de prix de la vente du pétrole russe par voie maritime. En effet, l’effort de guerre russe dépend en grande partie de la vente de gaz et du pétrole qui, en 2024, a représenté 108 milliards de dollars. Rien qu’une baisse du prix du baril sous les 60 dollars mettrait à mal les finances russes et sa capacité à financer l’effort de guerre.
Mais Trump n’a pas toutes les cartes en main pour faire plier Poutine
Vladimir Poutine veut une paix mais à ses conditions, ce qu’il appelle « une paix durable qui éradique les causes profondes du conflit ». Ces conditions comprennent ainsi l’annexion des cinq régions ukrainiennes au sein de la Russie à savoir Donetsk, Lougansk, Zaporijjia, Kherson et la Crimée, ainsi qu’une reconnaissance internationale. De plus, un accord supposerait que l’Ukraine renonce à son adhésion à l’Otan et ne bénéficie plus de livraisons d’armes occidentales. Dans ce cadre, il ne pourrait y avoir aucune activité militaire d’un pays tiers en Ukraine. L’armée ukrainienne se verrait imposer des plafonds en termes d’effectif, d’armes et d’équipements militaires. Le pays serait neutralisé comme ce que l’on a pu connaitre avec la Finlande. Enfin, l’Ukraine doit lever la loi martiale et organiser des élections présidentielle et législatives à l’issue de 100 jours.
Donald Trump fait face à une situation compliquée parce que les conditions imposées par Vladimir Poutine sont inacceptables pour les Ukrainiens. Le président américain doit ainsi conduire son homologue ukrainien à accepter davantage de concession, comme il a pu le faire lors de la rencontre tendue entre les deux hommes à la Maison Blanche en début d’année. De l’autre côté, il doit utiliser ses leviers pour que son homologue russe baisse également ses exigences. Ainsi, les derniers leviers économiques et militaires doivent conduire Vladimir Poutine à renoncer à une partie de ses demandes pour la paix.
Tout l’enjeu pour le locataire de la Maison Blanche est de donner suffisamment de garantie à la Russie que l’Ukraine n’intégrera pas le giron occidental et qu’elle ne constitue pas une menace, en neutralisant le pays d’une manière ou d’une autre. Dans le même temps, il doit donner suffisamment de garantie à l’Ukraine que la Russie n’attaquera pas de nouveau dans les années à venir, une fois que l’Ukraine soit démilitarisée et n’ait que peu de garanties de sécurité de la part des occidentaux.
William Thay, Président du think-tank gaulliste et indépendant Le Millénaire
Sean Scull est analyste du Millénaire, spécialiste de la politique américaine et auteur de le Populisme, symptôme d’une crise de la démocratie, comment le néolibéralisme a triomphé en France et en Suède, aux éditions L’Harmattan.
Pour soutenir nos analyses ou nous rejoindre pour rendre sa grandeur à la France
Crédit photo : President Trump & the First Lady’s Trip to Europe, de Trump White House Archived, via Flickr, sous licence PDM 1.0
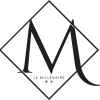

Add a Comment