16 mars 2020, Emmanuel Macron déclare la « guerre au virus » et décrète la mise en quarantaine de toute la population face à l’explosion de la Covid-19. Cette déclaration est à l’évidence la plus importante d’un Président de la République depuis la Seconde guerre mondiale. Elle ne s’adressait pas seulement aux soignants ou aux scientifiques, mais à l’ensemble des citoyens, appelés à consentir à une restriction drastique de leurs libertés au nom de la protection collective.
Ce 16 mars 2025 marque ainsi le cinquième anniversaire d’une décision qui aura bouleversé l’histoire de la France et son avenir : le confinement. Ce moment constitue une bascule de notre rapport à l’État et à la démocratie puisque jamais les politiques publiques ne pourront être conduites comme elles ne l’étaient auparavant.
Nous vivons désormais une troisième ère de l’État depuis 1945. La première est celle de l’État-providence keynésien au lendemain de la Seconde guerre mondiale qui accompagne les Trente Glorieuses en convertissant la croissance économique de la reconstruction et du dynamisme démographique en gains de protection sociale (Sécurité sociale, régimes de retraites, politique du logement, etc.). Seulement, l’État-providence keynésien est remplacé par l’État néolibéral thatchérien et reaganien après les chocs pétroliers qui s’accompagne de la crise de l’État providence, selon Pierre Rosanvallon[1]. Il s’agit de la deuxième ère de l’État qui s’est achevée après la succession des crises, n’ayant pas réussi à gérer les dernières comme la crise financière de 2008, la crise des dettes souveraines (gérée par une politique monétaire expansive sous Draghi) et désormais la crise sanitaire, puisque ce ne sont pas les remèdes néolibéraux qui ont permis la sortie de crise mais une approche hobbesienne (confinement) et très protectrice sur le plan social (quoi qu’il en coûte). Cette nouvelle ère de l’État qui s’ouvre semble davantage correspondre à un équilibre entre liberté et protection.
En effet, la gestion de la crise sanitaire a été marquée par une concentration extrême des pouvoirs dans les mains de l’exécutif, la marginalisation du Parlement et la montée en puissance des experts scientifiques comme nouveaux acteurs décisionnaires. Mais ce mode de gestion, bien que justifié par l’urgence et soutenu au lendemain de l’annonce, a engendré une défiance durable à l’égard des institutions. L’opacité des décisions, l’imprévisibilité des restrictions et la gestion technocratique du quotidien ont alimenté un sentiment de dépossession démocratique. D’autant plus que les tâtonnements et les difficultés ont affaibli la parole des experts.
Ainsi, quel est le modèle démocratique post-crise sanitaire ? Comment les Français ont-ils politiquement vécu la crise sanitaire et l’après-crise sanitaire ? Ce rapport revient sur l’acceptabilité politique de la guerre contre le Covid-19 (I), puis les conséquences politiques et sociétales du confinement qui a bouleversé notre lien démocratique (II) et enfin sur les ressorts du modèle démocratique et le rôle de l’État d’après la crise sanitaire (III), qu’il est nécessaire de comprendre puisqu’il conditionne l’élaboration, la réalisation et la mise en œuvre des politiques publiques de notre époque.
[1] Rosanvallon, P. La crise de l’État providence. Le Seuil, (2000)
Matthieu Hocque, directeur adjoint des Études du Millénaire
Denis Nicolaï, analyste au Millénaire
Crédit photo : Putin and Macron meeting with a large table, kremlin.ru, via Wikimedia Commons, sous license CC BY 4.0.
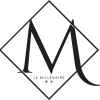

Add a Comment