L’École républicaine doit affronter le plus grand défi de son existence, plus grand encore qu’instruire toute la population : celui d’affronter la décivilisation. En effet, les dysfonctionnements de l’école liés à nos mauvais choix collectifs depuis une quarantaine ont alimenté le phénomène de « décivilisation » pour reprendre les mots du président de la République. Aujourd’hui, l’école républicaine devient la première victime de cette décivilisation avec la multiplication des faits divers devenus des faits de société (agressions d’enseignants, attaques au couteau, harcèlement, narcotrafic, etc.). Comment reprendre le contrôle de la situation ?
L’école devient un « territoire perdu de la République »
L’école de la République n’est plus un sanctuaire à l’abris des évolutions de la société. Alors que la société française, comme les autres sociétés occidentales, fait face à une ultraviolence (des actes d’une intensité violente de plus en plus importants) et une barbarisation (des actes de plus en plus barbares et sordides), l’école n’y échappe plus. Pour l’année scolaire 2023-2024, 74 agressions à l’arme blanche ont eu lieu uniquement dans le secondaire. Pire, selon la note d’information n°19.53 de la DEPP qui a structuré le rapport du Sénat sur l’insécurité à l’école, tous les jours, 2 à 3 enseignants sont menacés avec une arme dans notre pays. Désormais, chaque jour apporte son lot de faits d’agressions barbares à l’école jusqu’au meurtre des enseignants regrettés Samuel Paty et Dominique Bernard dans des établissements.
La décivilisation engendre une triple fracture au sein de l’école républicaine. Une fracture entre établissements, puisque les collèges et les lycées professionnels sont sur-représentés dans les faits de violence. Une fracture socio-territoriale, puisque force est de constater que les zones d’éducation prioritaires concentrent le plus ces tensions. Et enfin, une fracture culturelle car l’école devient traversée par les mêmes logiques de domination et de violence que le reste de la société. Le cas de l’école Émile Zola à Saint-Ouen, contrainte de délocalisation face aux points de deal, en dit long : l’État recule, les trafiquants eux, avancent. Cette insécurité multiforme (drogue, harcèlement, agressions) s’accompagne du sentiment d’impunité renforcé, par la désuétude et le laxisme de la justice des mineurs.
Le chef d’établissement, victime d’impuissance publique
Il est en première ligne de cette crise car il est le leader local tenu de piloter son établissement. Seulement, il doit composer avec un périmètre élargi de missions sans augmentation de moyens pour les réaliser. Un chef d’établissement doit chaque semaine réaliser une centaine de tâches qui n’étaient pas demandées avant la mise en place du système de décharge d’enseignement en 1982. De surcroît, n’ayant aucun poids politique au sein de l’établissement, il dépend donc de l’administration pour faire respecter l’ordre. Or, celle-ci lui impose la doctrine du « pas de conflit, pas de vague ». Cela explique le désamour entre la profession et le ministère car sa responsabilité s’élargit, mais son autorité s’effrite. En témoigne, la note édifiante de 3,7/10 attribuée au niveau de confiance du ministre résume ce divorce d’en haut.
En plus de cette contrainte « par le haut », le chef d’établissement doit composer avec une contrainte « par le bas ».Celle-ci s’illustre par les pressions exercées par les familles devenues dans certains établissements de plus en plus violentes. En théorie, il est le garant de l’ordre vis-à-vis d’elles. En pratique, il est un agent seul, sans pouvoir disciplinaire dissuasif, sans soutien juridique tangible, et sous la menace constante d’un recours administratif. Devenue symbolique, son autorité se heurte ainsi à l’impuissance institutionnelle, obligeant les agents à une stratégie de survie.
Faire du chef d’établissement un atout pour le maintien de l’ordre à l’école
Le chef d’établissement doit redevenir un atout pour remettre de l’ordre à l’école. Pour cela, il faut leur redonner autorité et moyens, pour reconstruire l’école en un véritable pilier républicain. Cela invite à une rupture rhétorique, politique, tant dans le discours que dans l’action. Première mesure symbolique : reconnaissons-leur ainsi qu’aux enseignants, le statut de dépositaire de l’autorité publique comme le policier ou le magistrat appuyée sur l’article 433-3 du Code pénal. Comme le policier incarne la loi dans l’espace public, le chef d’établissement comme le professeur doivent incarner la loi dans l’espace scolaire.
Ensuite, il faut leur offrir un cadre favorable pour reprendre la main sur la décivilisation. Cela passe par trois leviers. Premièrement, plus de pouvoir politique : les chefs d’établissement doivent disposer de plus de pouvoirs vis-à-vis des élèves comme des enseignants ce qui implique de renforcer l’autonomie des établissements. Deuxième levier, il faut libérer de leur temps pour la discipline, grâce à l’extension du régime parisien de décharge d’enseignement pour les chefs d’établissement, à tous les territoires. Enfin, il faut que leur pouvoir de sanction soit immédiat, ce qui implique d’une part un soutien juridique efficace et accru, et d’autre part, une simplification des procédures disciplinaires pour réduire le temps d’impunité.
C’est à ce prix que l’on évitera de transformer l’école en zone de non-droit. D’un soldat sans armure, il doit devenir le garant de l’ordre scolaire, juste et républicain. C’est en cela que nous pourrons restaurer la confiance dans l’institution et enrayer la spirale du déclin.
Marine Hannouna, Analyste du think-tank gaulliste et indépendant Le Millénaire, auteur du rapport « L’Ecole républicaine face à la décivilisation »
Matthieu Hocque, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire, spécialiste des politiques publiques
Pour soutenir nos analyses ou nous rejoindre pour rendre sa grandeur à la France
Crédit photo : 2020-10-21 12-05-53 rassemblement-Belfort, de Thomas Bresson, via Wikimedia Commons, sous licence CC BY 4.0.
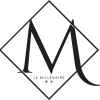

Add a Comment