Un peu plus de deux ans après les attaques terroristes du 7 octobre 2023, les discussions en Egypte autour du plan de paix proposé par Donald Trump pourraient permettre de mettre un terme à la guerre de Gaza. Les contours de cette paix, assortie d’une normalisation des relations entre Israël et les principaux pays arabes, représentent une opportunité historique : celle d’envisager la constitution d’une « grande alliance » à la fois régionale et globale durable contre le terrorisme islamiste et l’islamisme politique.
Depuis le 7 octobre 2023, l’ouverture d’une « troisième ère » pour le Moyen-Orient
Depuis 1945, le Moyen-Orient a schématiquement traversé deux ères. La première, de 1945 à 2001, est marquée par la logique de la guerre froide où les superpuissances américaine et soviétique s’affrontent par procuration autour d’enjeux politiques (le monde libre contre l’alliance socialiste entre l’URSS et la Syrie, l’Égypte, l’Irak et le Yémen du Sud), économiques (pour les Etats-Unis, l’approvisionnement en hydrocarbures ; pour l’URSS, les accords commerciaux d’exportations avec la Turquie, l’Iran ou encore l’Afghanistan dans les années 1970) et géostratégiques (pour les Etats-Unis, le contrôle du commerce maritime ; pour l’URSS, l’accès aux mers chaudes). La seconde, depuis les attentats du 11 septembre 2001, se traduit par l’essor de la menace islamiste sous différentes formes. Elle est non-étatique avec Al-Qaeda, puis la percée de Daech à la suite de la destruction de l’État irakien, mais aussi progressivement devenue étatique avec l’Iran constituant son « axe de la résistance » visant à détruire Israël et affaiblir le monde occidental.
Le 7 octobre 2023 a reconfiguré le Moyen-Orient. En effet, l’attaque terroriste subie par Israël et la riposte inflexible qu’il a déclenchée ont plongé le Moyen-Orient dans l’instabilité sur fond de guerre de l’ombre entre l’Iran des mollahs et l’État hébreu. Téhéran a mobilisé les membres de l’« axe de la résistance » dans le but de s’engouffrer dans la brèche ouverte par le Hamas et de mettre à terre Israël, ennemi intime du régime perse. Du Hezbollah aux Houthis, en passant par les milices chiites irakiennes, chacun des relais régionaux iraniens a apporté sa contribution au projet des Gardiens de la révolution. Seulement, cette guerre s’est avérée largement en défaveur de l’Iran : le Hamas est en grande difficulté à Gaza, le Hezbollah a perdu une grande partie de ses dirigeants en octobre 2024 et la Syrie d’Assad est tombée le 8 décembre 2024. Cette défaite progressive de l’« axe de la résistance » ouvre une fenêtre de tir pour une grande alliance de circonstances entre Israël et les pays ennemis et concurrents de l’Iran, notamment l’Arabie Saoudite, les Émirats-Arabes-Unis ou l’Égypte.
La Palestine, dernière entrave à la « grande alliance »
La situation palestinienne a bloqué le processus de normalisation des relations entre Israël et l’Arabie Saoudite ainsi que les autres pays arabes sunnites ne reconnaissant pas encore l’État hébreu. En effet, la conclusion des accords d’Abraham sous l’égide de Donald Trump à partir de septembre 2020 avait enclenché un cycle de normalisation des relations diplomatiques et commerciales entre Israël et des pays arabes tels que les Émirats arabes unis, Bahreïn, mais aussi d’autres États comme le Maroc et le Soudan. Cette spirale positive avait été stoppée par le début de la guerre à Gaza, les États arabes ne pouvant plus la justifier auprès d’opinions publiques solidaires des Gazaouis. L’Arabie Saoudite, par la voix de Mohamed Ben Salman, faisait dès lors du règlement de la question palestinienne une condition sine qua none de la normalisation de ses relations avec l’État hébreu.
Un accord imminent de paix entre Israël et le Hamas est l’occasion de neutraliser le danger que représente l’influence de la République islamique d’Iran. Cet accord de paix, historique s’il venait à se concrétiser, contribuerait à pacifier durablement la région car il mettrait fin au dernier antagonisme entre Israël et l’Arabie Saoudite. De plus, il créerait des intérêts réciproques économiques et commerciaux. Enfin, il ouvrirait un élan inédit pour une coopération militaire entre deux armées puissantes (plus de 300 milliards de dollars de dépenses cumulés pour les deux pays en 2025, soit plus de 10% des dépenses militaires mondiales pour seulement 0,55% de la population mondiale) et complémentaires en associant le renseignement et la technologie israélienne à la force de frappe aérienne saoudienne.
Une grande alliance contre l’islamisme sous toutes ses formes
Il s’agit en quelque sorte de s’inspirer de la grande coalition contre Daech en lui adjoignant une mission étendue tant géographiquement, afin de pouvoir neutraliser les proxys iraniens, que stratégiquement de manière à permettre la réalisation d’objectifs politiques et diplomatiques. Cela passe tout d’abord par la poursuite du but partagé entre Washington et Beyrouth de désarmer le Hezbollah. Le cessez-le-feu conclu entre Washington et les rebelles yéménites Houthis doit également être étendu au bénéfice d’Israël, des pays du Golfe et de l’Égypte pour préserver leurs intérêts économiques. Couper les différents axes reliant le régime islamiste iranien à ses proxys permettra de porter un coup fatal à son influence.
Au-delà de la destruction de « l’axe de la résistance », de tels progrès seraient une réelle avancée pour affaiblir l’Iran sur le plan intérieur. L’Iran ne renoncera pas à l’acquisition de l’arme atomique. Son effet de dissuasion est utilisé par les Mollahs pour préserver le régime islamiste et son influence régionale puisqu’elle est régulièrement brandie contre Israël et les ennemis du régime. Une grande alliance régionale soutiendra un traité nucléaire restrictif excluant tout enrichissement d’uranium, même à des fins civiles.
Dernière menace islamiste, l’État islamique (ou Daech) réveille lentement les cellules dormantes dont il dispose en Irak et surtout en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad. Ce danger doit être pris au sérieux car ses dirigeants semblent avoir compris que l’établissement d’un nouveau califat est matériellement impossible. Ils ont adopté une approche plus diffuse visant à mener un jihad global. Cela justifiera une guerre totale que pourront mener les forces israéliennes, arabes et occidentales après avoir neutralisé l’« axe de la résistance ».
La France doit comprendre et s’inscrire dans ce basculement historique pour encourager toutes les initiatives permettant la constitution d’une « grande alliance ». Il en va de son image à l’international mais aussi, eu égard aux menaces que représentent le terrorisme islamiste et l’islamisme politique en France, de sa sécurité intérieure et de celle de ses citoyens.
Matthieu Hocque, Directeur adjoint des Études du Millénaire, co-auteur du rapport « Comment le 7 Octobre a reconfiguré le Moyen-Orient »
Edouard Chaplault-Maestracci, Analyste International, co-auteur du rapport « Comment le 7 Octobre a reconfiguré le Moyen-Orient »
Pour soutenir nos analyses ou nous rejoindre pour rendre sa grandeur à la France
Crédit photo : Die Hamas hat sich nach eigenen Angaben offen für Verhandlungen über den US-Friedensplan gezeigt, via Heute, sous licence CC BY 4.0.
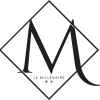

Add a Comment