La France se distingue par un nombre élevé de jours de grève, souvent considéré comme un record mondial. En 2022, près de 2,4 millions de jours de grève ont été comptabilisés dans le secteur privé et la fonction publique d’État, une année relativement calme sur le plan social. Toutefois, ce chiffre pourrait atteindre environ 3,3 millions de journées perdues lorsque l’on inclut les grèves dans la fonction publique territoriale et hospitalière, pour lesquelles il n’existe pas de données officielles.
La revendication principale des salariés français est de gagner plus, notamment dans un contexte de réduction du pouvoir d’achat eu égard à l’inflation. Selon un baromètre de l’ADP portant sur 2 000 salariés français représentatifs, 61% des salariés français indiquent que leur rémunération est l’élément déterminant dans leur travail. Pourtant, malgré un nombre important de jours de grèves, les Français estiment percevoir des salaires insuffisamment hauts. En effet, plus de la moitié (54%) des salariés français estiment ne pas suffisamment être bien payés. Ainsi, malgré un dialogue social dur et une opposition syndicale vigoureuse, la principale revendication des travailleurs français n’est pas accomplie. Ce paradoxe illustre la mauvaise qualité du dialogue social en France entre les représentants du personnel et les employeurs autant publics que privés.
Les années marquées par des conflits sociaux, peuvent voir ce nombre doubler, comme en 2019 avec 4,7 millions de jours de grève de 2019 lors de la réforme des retraites, illustrant l’ampleur des mobilisations en France. Les syndicats traditionnels, tels que la CGT et la CFDT, semblent souvent débordés et ne sont plus systématiquement consultés par les travailleurs. De plus, ils sont fréquemment contournés par des mouvements sociaux autonomes ou des collectifs informels qui s’organisent sans leur intervention. Cette dynamique est particulièrement visible lors des grèves programmées en lien avec des événements majeurs, comme les départs en vacances ou les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ces mouvements sont souvent utilisés comme levier pour peser sur les négociations en cours. L’impact économique des grèves est également significatif. Selon certaines estimations, le coût total des grèves pour l’économie française pourrait atteindre quatre à cinq milliards d’euros. Dans le secteur des transports, par exemple, la SNCF perd environ 25 millions d’euros par jour de grève. Les commerces ne sont pas épargnés non plus : lors des journées de mobilisation, le chiffre d’affaires peut chuter de 19 % en moyenne.
Alors qu’il ne parvient plus à améliorer la vie des Français et leur pouvoir d’achat tout en étant largement utilisé, nous pouvons nous demander si le droit de grève n’a pas été dévoyé. A cet égard, nous pourrions envisager des propositions pour mieux encadrer son utilisation. Des mesures récentes au Sénat ont déjà commencé à limiter le droit de grève dans certains secteurs, notamment dans les transports. De plus, un député a proposé une interdiction de manifester pendant 60 jours lors de périodes critiques. Ces initiatives soulignent la nécessité d’un débat approfondi sur le droit de grève et ses implications pour la société française.
Par Clément Perrin, Directeur des Etudes du Millénaire
Crédit photo : 09042018 Cheminots en EG et rassemblés devant l’assemblée nationale45, Force Ouvrière, via Flickr, sous License CC BY-NC 2.0.
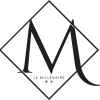

Add a Comment