Les élections fédérales allemandes du 23 février 2025 marquent un tournant décisif dans l’histoire politique du pays. À bien des égards, elles ne sont pas seulement un scrutin législatif ordinaire, mais le reflet d’une crise politique et institutionnelle profonde, symptomatique des bouleversements qui traversent l’ensemble des démocraties européennes. L’Allemagne, longtemps perçue comme un modèle de stabilité, est aujourd’hui confrontée à un phénomène inédit : la fragmentation et la polarisation de son paysage politique, l’érosion de la confiance envers les partis traditionnels et la montée en puissance des formations populistes, tant à droite qu’à gauche.
Ce phénomène pose une question essentielle : l’Allemagne est-elle en train de devenir une démocratie ingouvernable ? De même, comment la culture du « compromis à l’allemande » peut-elle survivre dans un contexte de fragmentation et de polarisation électorale ?
L’histoire politique allemande a toujours été marquée par la nécessité de compromis. Dès la République de Weimar (1919-1933), l’incapacité des partis modérés à stabiliser un système parlementaire fragmenté avait conduit à une crise institutionnelle majeure, facilitant l’ascension du nazisme. Après 1949, la République fédérale a justement cherché à éviter ces erreurs, en instaurant un système politique hybride alliant représentation proportionnelle et stabilité institutionnelle. Ce modèle, longtemps efficace sous l’égide de la CDU/CSU et du SPD, semble désormais atteindre ses limites. Les élections de 2021, puis l’échec du gouvernement Scholz en 2024, témoignent de cette nouvelle ère d’incertitude où aucune majorité claire ne semble émerger, rendant la gouvernabilité du pays de plus en plus difficile.
Au-delà des considérations purement électorales, cette instabilité politique s’inscrit dans un contexte plus large, marqué par plusieurs limites structurelles liées au fait que le merkelisme n’a pas bien préparé l’Allemagne à la nouvelle ère. En effet, en privilégiant la recherche de la prospérité au détriment de la souveraineté, l’Allemagne était prête à vivre dans un monde pacifié et de progrès. Or, la réelection de Trump, le durcissement de la stratégie chinoise, le réveil des nations-empires comme la Russie de Poutine ou la Turquie d’Erdogan rendent impérative la recherche de souveraineté. Dépendante des Etats-Unis sur le plan militaire, de la Russie sur le plan énergétique et de la Chine sur le plan économique, l’Allemagne n’est pas prête.
Ainsi, ces élections constituent bien plus qu’un simple test électoral : elles sont le baromètre d’une crise systémique qui pourrait redéfinir durablement l’équilibre politique allemand. Pour trois raisons majeures, le pays s’apprête à basculer dans une dynamique proche de celle observée en France après les élections législatives du 7 juillet 2024.
L’axe de la droite et de l’extrême droite a gagné en influence au sein de l’opinion publique allemande. La CDU, le parti conservateur historique, recueille aujourd’hui entre 30 et 35 % des intentions de vote. L’AfD, parti populiste de droite radicale, progresse fortement avec des estimations oscillant autour de 20 %. Ensemble, ces deux formations pourraient constituer une majorité parlementaire. Cependant, cette majorité théorique dans les intentions de vote ne se traduit pas en une capacité effective à gouverner. La CDU, sous la pression de la droitisation de son électorat et d’une concurrence accrue de l’AfD, a durci son discours, mais a maintenu le cordon sanitaire. Alors que toute union des droites est impossible alors d’autres alliances doivent être trouvées.
Deux options sont possibles : une coalition CDU/SPD plus des partis pivots, mais le déclin du SPD et sa radicalisation à gauche posent deux limites. Celle de l’obtention de la majorité qui n’est pas certaine et celle de la gouvernabilité. Un pacte de non-censure comme en France pourrait être expérimenté. Seconde option, la constitution progressive d’une union des gauches sur le modèle du NFP avec un SPD et des Verts qui pourraient être attirés plus à gauche (à l’image du PS français d’Olivier Faure en 2022 et de Benoit Hamon en 2017) pour composer une alliance avec une gauche radicale encore désunie. Ainsi, on pourrait assister à un renversement des alliances si l’union des droites bloque le pays à l’image de l’Espagne, où Pedro Sanchez (PSOE) a réussi à former une coalition allant du centre-gauche à l’extrême gauche sans être majoritaire. Mais les dissensions entre les forces de gauche restent, pour l’heure, un frein à la constitution d’une alternative claire et cohérente.
Cette note propose d’analyser en profondeur les enjeux des élections fédérales allemandes de 2025, en revenant sur les dynamiques politiques qui ont conduit à cette situation, les forces en présence et les scénarios possibles pour l’avenir. Elle vise à éclairer les défis auxquels l’Allemagne est confrontée et les différents scénarios probables après ces élections anticipées.
Par Pierre Clairé, Directeur Adjoint des études du Millénaire.
Crédit photo : 2016 Berlin Christmas market truck attack, EuroBill, via Wikimedia Commons, sous licence CC0 1.0.
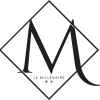

Add a Comment