25 ans après son adoption, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) est devenue le symbole d’une politique du logement qui, loin de résoudre la ségrégation, l’a aggravée. L’objectif était louable : imposer un quota de 25 % de logements sociaux dans les communes urbaines pour favoriser la mixité sociale. Sur le papier, il s’agissait de casser les logiques de concentration de la pauvreté. Dans la réalité, le résultat est catastrophique : les ghettos urbains parisiens, marseillais et lyonnais ont été reproduits à l’identique dans toutes les villes françaises, créant des problématiques de délinquance et de narcotrafic jusqu’à Limoges ou Châteauroux.
La ghettoïsation des banlieues françaises
La banlieue française représente la modernité française à partir des années 1960. En effet, elle repose sur deux investissements majeurs de l’État dans le cadre de sa politique du logement post-1945. D’une part, dans le logement social pour répondre afin de donner l’accès à un logement à un prix raisonnable au plus grand nombre des Français dans le cadre des Trente Glorieuses. A partir de 1958, l’État a mis en place de nombreuses zones à urbaniser en priorité (ZUP), en périphérie des centre villes afin d’y loger la classe populaire et ouvrière à travers des cités, des grands ensembles dont la cité des 4000 à la Courneuve. D’autre part, dans la lutte contre l’habitat indigne, avec la loi Vivien à partir de 1970 qui facilite la rénovation des habitats insalubres et permet de résorber les bidonvilles comme celui de Nanterre qui concentre une grande partie de la main d’œuvre d’origine étrangère arrivée après la décolonisation.
Seulement, les banlieues françaises principalement localisées en région parisienne, marseillaise et lyonnaise sont progressivement devenues des ghettos urbains. Si les causes sont nombreuses, deux sont essentielles. D’un côté, si les métropoles sont les principaux espaces de création de richesses (75% du PIB selon l’OCDE), les banlieues françaises sont paradoxalement restées en marge de cette création de richesses. Le taux de pauvreté est de 44,3% dans les Quartiers prioritaires de la Ville, soit 3 fois supérieur au territoire national en 2023. Sur cette brèche s’est construite une économie souterraine informelle et bien souvent criminelle, avec une explosion des faits constatés d’infractions en matière de stupéfiants, quasi-nuls en 1975, mais dépassant les 100 000 faits constatés au tournant des années 2000 et triplant depuis. De l’autre côté, la concentration de populations étrangères et d’origine étrangère en provenance d’Afrique (Maghreb et Afrique subsaharienne) dont l’assimilation n’a été ni exigée, ni réussie a créé des populations s’émancipant de plus en plus de la puissance publique.
La loi SRU, une loi typiquement socialiste
La logique de la loi SRU est profondément socialiste. Elle consiste à répartir les efforts de construction de logements sociaux en les imposant les villes qui en manquaient sous peine d’amende. C’est en quelque sorte une logique égalitariste. Pour atteindre le quota, de nombreuses communes ont dû construire massivement, souvent à la hâte, et avec une population cible qui s’est révélée très spécifique. Ainsi, des quartiers sont nés ou ont atteints des seuils critiques où le pourcentage de logements sociaux dépasse largement le seuil requis, créant des « mini-ghettos » là où il n’y en avait pas.
À l’inverse, les communes les plus riches et les plus attractives ont souvent choisi de payer les amendes plutôt que de construire. Elles préfèrent s’acquitter de la pénalité financière, dérisoire au regard de leur budget, plutôt que de voir leur paysage immobilier et social se transformer, comme la commune de Neuilly-sur-Seine, qui ne concentre que 6,7% de logements sociaux sur son territoire. L’État avait attaqué la commune pour le non-respect des obligations législatives en matière de logements sociaux. La Cour Administrative de Versailles en 2019, a donné raison à la commune en mettant en avant le principe de l’emprise foncière et du plan local d’urbanisme (PLU). Celui de la commune de Neuilly-sur-Seine empêche toute construction verticale et son emprise horizontale est déjà saturée. C’est à travers ces exemples que des communes ont trouvé des parades pour ne pas appliquer le taux de 25% de logements sociaux sur leur territoire.
La loi SRU a étalé la ghettoïsation et la délinquance, elle doit être abrogée
Cette loi représente tout ce que l’on peut reprocher au socialisme, à savoir lutter contre la pauvreté, mais malgré tout l’entretenir ; et lutter contre l’absence de mixité et créer des inégalités territoriales. En effet, d’un côté, des villes moyennes contraintes de s’endetter pour construire des logements sociaux, de l’autre, des communes aisées qui s’achètent le droit de refuser la mixité. De plus, la multiplication des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans une volonté d’annihiler les disparités territoriales est un échec car la pauvreté n’a jamais été aussi importante dans les banlieues et dans les centres villes, hormis Marseille qui subit le phénomène inverse, où c’est le centre-ville qui est pauvre et la périphérie qui est riche. En somme, le problème n’est pas que Neuilly-sur-Seine ne remplisse pas le cahier des charges de la loi SRU comme peut le faire Saint-Denis, mais qu’il y ait trop de Saint-Denis et pas assez de Neuilly-sur-Seine.
En imposant des quotas, la loi SRU n’a pas tenu compte de la réalité du marché et des spécificités locales. Elle a créé un modèle uniforme qui ne prend pas en compte le tissu social déjà en place. Les bailleurs sociaux, pour respecter les quotas, ont concentré la construction de logements sociaux dans des zones déjà fragiles ou en périphérie, loin des centres-villes dynamiques et des bassins d’emploi. Or, en empilant des logements sociaux sans les équipements nécessaires, on a créé des cités-dortoirs isolées, où les habitants se retrouvent face à des difficultés économiques mais aussi sécuritaires.
En politiques publiques, la pire législation possible est celle qui accentue les problèmes qu’elle prétend combattre. Il est donc urgent de tirer les leçons de cet échec et repenser en profondeur notre politique du logement centré autour de quelques principes. Le logement social est un effort de la société dû à ceux y contribuent activement et que « nos économies rémunèrent si mal » pour paraphraser le président de la République (policiers, auxiliaires puéricultrices, aides-soignantes, femmes de ménage, etc.) (1). C’est la diversification de l’offre de logements (accession à la propriété, logements intermédiaires) et non son uniformisation qui sera en mesure de créer une véritable diversité sociale (2).
La loi SRU a échoué car elle repose sur une idéologie déconnectée du réel. Ajoutée à une philosophie permissive envers les délinquants, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les élus socialistes ayant voté cette loi portent la responsabilité de l’étalement de la ghettoïsation et de la délinquance dans toutes nos villes.
Jonathan Bevis, Expert au Millénaire des questions territoriales, auteur du rapport « Le logement, l’Absurdistan à la française »
Pour soutenir nos analyses ou nous rejoindre pour rendre sa grandeur à la France
Crédit photo : Snake @ Tours Aillaud / Cité Pablo Picasso @ La Défense @ Paris, de Guilhem Vellut, via Flickr, sous licence CC BY 2.0.
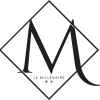

Add a Comment