« Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité. On y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu’il faudra, mais ça sera nettoyé ». C’est ainsi que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, prononce ces mots dans la cité des 4 000 à la Courneuve, à la suite de la mort de Sid-Ahmed Hammache, un enfant de 11 ans tué d’une balle, victime d’une rixe entre deux bandes.
Devant les habitants, le locataire de la Place Beauvau adopte un discours tant ferme que clivant, fondé sur une rhétorique manichéenne : il oppose systématiquement les comportements, affirmant que « ceux qui ne respecteront pas la loi, on les tapera durs ; ceux qui veulent s’en sortir, on les aidera forts. »
Si la volonté politique de reconquérir les quartiers en difficulté a été réaffirmée à de nombreuses reprises depuis la phrase-choc de Nicolas Sarkozy, les effets concrets restent limités et les indicateurs économiques, sécuritaires, éducatifs et culturels sont dans le rouge. Ce décalage tient à une série de freins structurels, qui combinent rigidité juridique, complexité institutionnelle et inertie socio-économique. Loin de produire des résultats durables, l’action publique se heurte à des’obstacles qui fragilisent la continuité, l’efficacité et la légitimité de l’action publique.
Il est nécessaire d’enfin passer le Kärcher dans les quartiers sensibles. Or, cela ne se décrète pas comme nous venons de le démontrer. En revanche, cela passe par identifier les verrous et les blocages précis pour les lever. Une telle mesure est attendue par tous car aujourd’hui toutes les enquêtes d’opinion montrent que deux tiers des Français, incluant des Français de gauche, considèrent que l’insécurité est une priorité et qu’il faut prendre des mesures plus fermes.
Ainsi, « passer le Kärcher » sera bénéfique pour tous. Pour les habitants des quartiers populaires, qui ne redoutent plus le changement mais qui l’attendent avec impatience à la différence de leur réaction après les émeutes de 2005. En effet, en 2005, la logique d’apaisement chiraquienne prévalait sur la logique sécuritaire. Or, en 2023, la logique de fermeté prévaut sur la logique d’apaisement.
De plus, la population française, en particulier dans les territoires ruraux, perçoit de plus en plus la politique de la ville comme un échec coûteux. Cette perception alimente un sentiment d’injustice et de défiance vis-à-vis des décideurs politiques. En effet, les moyens financiers et humains massivement concentrés sur les quartiers urbains dits « prioritaires » sont souvent comparés, dans le monde rural, à un désintérêt persistant de l’État pour les difficultés locales : désertification médicale, fermeture des services publics, isolement numérique ou encore dévitalisation économique. Autrement dit, les territoires ruraux ont le sentiment d’être les grands oubliés des politiques publiques, alors même qu’ils partagent parfois des problématiques similaires (pauvreté, sentiment d’abandon, recul de l’autorité). Ce déséquilibre dans l’allocation des ressources nourrit un ressentiment croissant, et participe d’une fracture territoriale de plus en plus visible qui pourra à terme conduire à un refus au consentement à l’impôt.
Par Maxime KINDROZ, Analyste au Millénaire
Matthieu HOCQUE, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire
Pour soutenir nos analyses ou nous rejoindre pour rendre sa grandeur à la France
Crédit photo : Nicolas Sarkozy, French Minister of the Interior – 2003, de Christian Lambiotte / European Communities, 2003 / EC – Audiovisual Service, via Wikimedia Commons, sous license, CC BY 4.0.
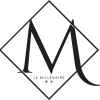

Add a Comment