Dans leur Enquête internationale sur l’enseignement des mathématiques publiée en 1985, les chercheurs Émilie Barrier et Daniel Robin décrivaient comme excellents et bien au-dessus de la moyenne, les résultats des élèves français dans l’évaluation internationale de l’IEA conduite en 1981[1]. L’enseignement français était alors mondialement admiré pour la qualité de son enseignement, son modèle méritocratique, ses examens nationaux exigeants et le niveau élevé de ses élèves[2].
Quarante ans après, le ton est tout autre. Le rapport remis au ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer le 21 mars 2022 le reconnaissait sans ambages : « le niveau moyen de compétences en mathématiques en France est en baisse depuis près de quarante ans […] quel que soit l’outil d’évaluation mobilisé »[3]. Son successeur, Pap Ndiaye, avait élargi par la suite le constat à l’ensemble des disciplines dans une tribune au Monde[4] :« les résultats aux évaluations nationales et internationales ne sont pas satisfaisants. Disons-le clairement : le niveau d’ensemble baisse ! ». Même les sociologues de l’éducation les plus rétifs à la thèse de la baisse du niveau, comme François Dubet, le reconnaissent désormais sans détour : « j’ai évolué […] car il y a aujourd’hui des enquêtes internationales PISA qui prouvent de manière incontestable que le niveau est mauvais […] Aujourd’hui, on n’a plus de garantie de niveau minimum »[5]. Le consensus est désormais établi : le niveau global a non seulement baissé mais il se situe à un niveau médiocre.
Ces constats se sont traduits dans la vie de tous les jours lors de l’accueil de 70 000 élèves ukrainiens depuis mars 2022 : les élèves ukrainiens sont meilleurs en mathématiques que les élèves français et considèrent que le niveau est souvent trop facile dans les classes françaises alors qu’ils ne maitrisent pas parfaitement la langue d’enseignement ![6]
L’unanimité autour de ce constat est toutefois relativement nouvelle. Elle succède à une longue période de controverse où une partie de l’intelligentsia soutenait que le niveau éducatif s’élevait en France tandis que l’autre fustigeait l’effondrement scolaire des élèves français, sans que cette querelle ne puisse être tranchée de manière décisive. Dans un épisode de la célèbre émission télévisée Apostrophes datant du 10 mai 1985, le sociologue Pierre Bourdieu répondait aux tenants de la thèse du déclin en affirmant que « personne n’a mesuré ce déclin catastrophique du système d’enseignement ». Le sociologue Christian Baudelot, dans son livre Le niveau monte (1989),soutenait le contraire, avec à l’appui de sa thèse, les chiffres de la hausse de la proportion de bacheliers d’une même classe d’âge[7] ou de celle des diplômés de l’enseignement supérieur. Plus récemment, une note[8] du Centre national d’étude des systèmes scolaires (CNESCO) de 2016 affirmait : « les élèves issus de l’immigration suivent une tendance également observée pour les élèves français d’origine : le niveau scolaire à l’entrée en 6e s’est élevé». À ces constats résolument optimistes répondaient les tenants de la thèse du déclin qui déplorent une école qui ne remplit plus sa mission première de transmission des savoirs : de la Lettre aux futurs illettrés de Paul Guth en 1980 à L’école fantômedu philosophe Robert Redecker en 2016, en passant par L’enseignement de l’ignorance de Jean-Claude Michéa en 1999 ou par La fabrique du crétin de Jean-Claude Brighelli en 2005, ces auteurs brossent le tableau d’une école française sujette à un effondrement académique et culturel. En l’absence de preuves irréfragables de la baisse de niveau, cette controverse se réduisait à un affrontement purement idéologique opposant « conservateurs et progressistes » ou « pédagogues et républicains »[9]. Un conflit que ne pouvait mieux résumer le titre du livre dirigé par le philosophe Alain Finkielkraut en 2009, La querelle de l’école.
La médiatisation à intervalles réguliers des performances des élèves français dans les études internationales a rendu la discussion plus consensuelle. L’école est désormais dite en crise et le niveau global médiocre. Mais si le diagnostic général est entendu, les causes de ce déclin restent, elles, très débattues. Certains, comme l’Observatoire des inégalités, expliquent la baisse de niveau par une « école formatée pour les enfants des parents diplômés » et qui dévalorise « les enfants qui échouent »[10]. D’autres encore, comme Christian Baudelot dans l’Élitisme républicain (2009), pointent un système qui privilégie une élite scolaire au détriment du reste des élèves au contraire de systèmes plus égalitaires comme celui de la Finlande, saluée alors pour ses performances dans PISA. Emmanuel Todd dans La lutte des classes au XXIe siècle (2020) quant à lui, perçoit une similitude entre la trajectoire éducative de la France et des États-Unis et voit dans la prolifération du temps passé devant les écrans, une cause commune au déclin éducatif des deux pays. Enfin, certains, comme Philippe Nemo dans Repenser l’enseignement (2024), mettent en cause les réformes pédagogiques qui auraient mis à mal la transmission des savoirs fondamentaux au sein d’un système qui a abandonné ses exigences au nom d’une vision dévoyée de l’égalité.
Si des hypothèses aussi diverses et contradictoires continuent d’être avancées, c’est sans doute parce que les maux dont souffre l’école française demeurent mal identifiés. La prise de conscience d’une crise éducative est réelle, mais son ampleur véritable ainsi que sa nature restent largement méconnues. La présente étude entend y remédier et propose un diagnostic précis en s’appuyant sur les données empiriques les plus solides et sur les enquêtes publiques les plus rigoureuses. Car seule une compréhension juste et éclairée de cette crise permettra d’orienter la réflexion sur les causes du déclin scolaire et de penser des réformes politiques efficaces. En particulier, cette note s’attachera à explorer différentes dimensions de la crise éducative française, dont certaines sont souvent négligées sur le sujet :
- La crise dans le temps : le déclin actuel constitue-t-il une rupture historique par rapport aux performances des générations précédentes ? À quel moment s’est-il amorcé et quelle est son ampleur réelle ?
- La crise dans l’espace : la France connaît-elle un déclassement par rapport à des pays de taille ou de niveau économique comparable ? A contrario, quels systèmes éducatifs font figure aujourd’hui de référence dans le domaine de l’enseignement ?
- Le caractère systémique ou localisé de la crise : le déclin est-il homogène ou varie-t-il selon le profil des élèves ? Les meilleurs élèves sont-ils également touchés ? Quels niveaux d’enseignement et quelles disciplines – littéraires ou scientifiques – sont les plus affectés ?
- L’influence des inégalités sociales et de l’ascendance migratoire sur la crise : le déclin est-il le simple reflet d’un accroissement des inégalités sociales ? L’immigration joue-t-elle un rôle dans la baisse de niveau ?
Dans un premier temps, nous présenterons la démarche permettant d’évaluer le niveau éducatif des élèves (1), puis ce que nous disent les données de statistiques de ce déclin éducatif (2) et enfin pourquoi il s’agit d’un produit du système éducatif et non de variables exogènes (3).
Pour soutenir nos analyses ou nous rejoindre pour rendre sa grandeur à la France
Crédit photo : Education : Entre montée des besoins et réformes néolibérales, de Bruce Matsunaga, sous licence CC BY-SA 3.0.
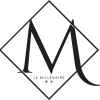

Add a Comment